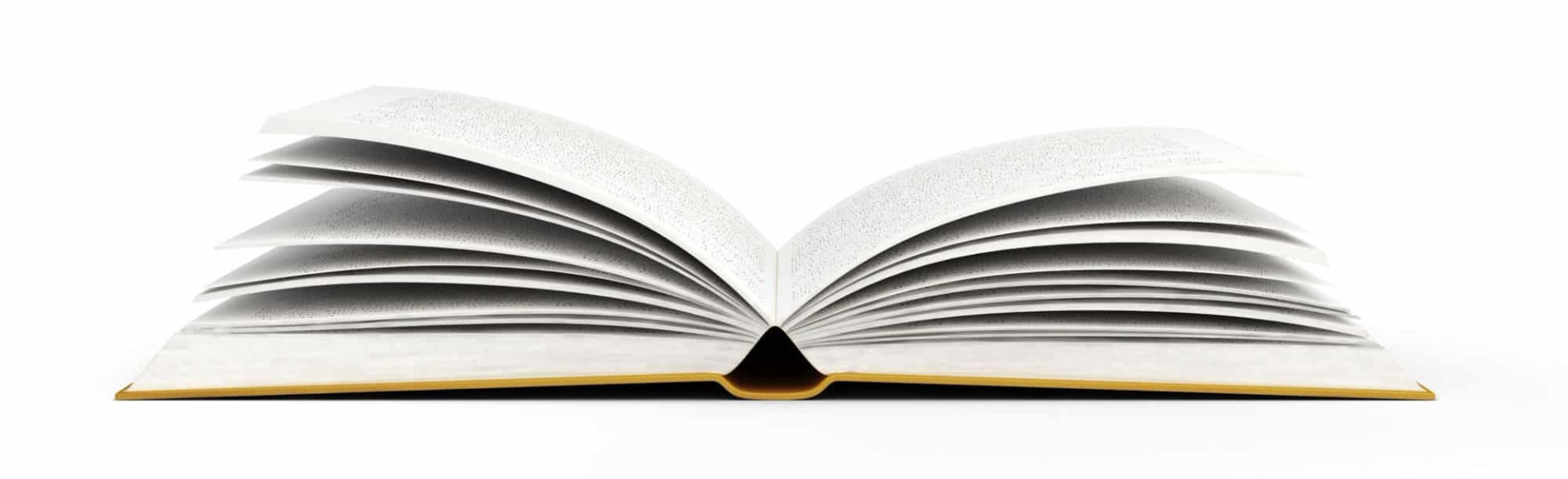CHAPITRE 1
Chapitre 1 : Do majeur - Introduction, Bach
Chant d'allégresse et de reconnaissance
Bach : Le premier prélude du WTC
Jessica se présente
Bach achève la composition du Clavier bien tempéré en 1722; il comporte une suite de Préludes er Fugues dans toutes les tonalités.
Un texte de Pierre Carrive
Un nouveau compromis
Le Clavier bien tempéré, ou Préludes, et Fugues a travers tous les tons et demi tons, concernant tant la tierce majeure, en Ut Re Mi que la tierce mineure en Re Mi Fa. Au profit et à /usage de le jeunesse musicienne avide d'apprendre, et aussi pour le passetemps de ceux qui sont habiles en cette étude, Composé et rédige' par Jean Sébastien Bach, actuellement Maître de Chapelle de Son Altesse le prince d`Anhalt-Coethen et directeur de la Musique de Chambre. L'an1722.
Voici la traduction du titre complet que Bach a donné à son Premier livre du Clavier bien tempéré (le titre original, en allemand, est : « Das Wohltemperierte Klavier>>). Le Second livre, publié vingt-deux ans plus tard, porte simplement ce titre : 24 Préludes et Fugues, Pourtant, les deux recueils sont construits de manière strictement identique, et poursuivent les mêmes objectifs pédagogiques et musicaux. Mais en 1744, en très grande partie grâce à Bach et, précisément, à ce Premier livre, le « tempérament égal » s'était tellement bien imposé qu'il n'était plus nécessaire d'en préciser l'utilisation.
Qu'est-ce que ce ii tempérament égal ? Sans rentrer dans des considérations trop techniques, il faut savoir qu'il existait alors plusieurs manières d'accorder (c'est-à-dire de régler la hauteur de chaque note) les instruments à clavier, qui dépendaient des tonalités dans lesquelles ils étaient utilisés. Pour que ces tonalités sonnent bien, il fallait en effet privilégier certains intervalles, au détriment d'autres. Au début du XVIIIe siècle, les tonalités changeaient peu au cours d'un même morceau, et il était courant de jouer des « Suites », faisant s'enchaîner plusieurs mouvements, tous dans la même tonalité.
Ce que Bach nomme « bien tempéré », c'est en réalité un compromis qui permet de jouer dans toutes les tonalités. Certains intervalles doivent être diminués ; autrement dit, ii tempérés. Avec cet accord, l'octave est divisée en douze demi-tons (le plus petit intervalle sur un instrument a clavier) égaux (d'où l'autre nom de « tempérament égal »). Aucune tonalité n'est alors privilégiée. Chacun des vingt-quatre diptyques « Préludes et Fugues » de ce Premier livre étant écrit dans une tonalité différente l'ensemble couvrant toutes les tonalités majeures et mineures existantes), cette nouvelle manière d'accorder était la seule qui permettait de jouer l'ensemble de cet ouvrage sans être obligé d'accorder vingt-quatre fois l'instrument. Par la suite, l'écriture devenant de plus en plus complexe, ce « tempérament égal » deviendra incontournable.
Notons au passage que Bach ne fut pas le premier à composer une œuvre qui utilise toutes les tonalités En 1719, par exemple, Johann Mattheson publia un traité de basse continue dans les vingt-quatre tonalités majeures et mineures. Mais il s'agissait de simples exercices.
Le Clavier bien tempéré nous emmène dans des sphères bien plus élevées. Reconnaissons tout de même a Mattheson d'avoir eu en partie raison avant d'autres, quand il écrivait dès 1719 :
Dans cent ans, pour autant que le Jugement dernier ne s'y oppose pas, les musiciens traiteront fa dièse majeur et ut dièse mineur avec autant d'aisance que nos organistes de village jouent aujourd'hui en ut majeur. Il n'avait cependant pas deviné que près de deux cent cinquante ans plus tard, Schonberg mettrait au point la musique « dodécaphonique » qui donne autant d'importance à chacun des douze sons de la gamme, et qui n'aurait pas pu voir le jour sans cette notion de « tempérament égal ».
Quel instrument ?
Il est significatif que Bach n'ait pas précisé exactement pour quel instrument il avait écrit son Clavier bien tempéré. À cette époque, le mot « Klavier » pouvait tout aussi bien désigner le clavecin, le clavicorde, l'orgue, voire le piano-forte (qui n'en était cependant qu'à ses débuts).
Pendant longtemps, en France, il n'a été question que du Clavecin bien tempéré, car, de fait, l'intégralité des deux cahiers ne pouvait alors être jouée qu'au clavecin, puisqu'il manquait des notes au clavicorde pour jouer certaines - peu nombreuses au demeurant - pièces du Second Livre. Rien n'interdit cependant de le jouer sur plusieurs instruments, comme l'a fait Robert Levin qui, dans son enregistrement réalisé en 2000, utilise cinq instruments différents : deux clavecins, un clavicorde, un orgue et un pianoforte.
Le Clavier bien tempéré s'adapte du reste parfaitement à l'évolution des instruments à clavier, comme le prouvent les excellentes exécutions et enregistrements sur piano moderne. Ici,
Deux autres chefs d'œuvre tardifs de Bach que l'on a coutume de comparer au Clavier bien tempéré, pour la prouesse qu'ils représentent, pour leur portée didactique, mais surtout pour leurs très hautes qualités artistiques, sont eux aussi dépourvus d'indications précises sur les instruments qu'ils nécessitent : L'Offrande musicale et L'Art de la Fugue. Comme si ne comptait réellement que l'essentiel : la musique, la musique « pure » , dégagée de toute considération pouvant nous détourner de son message le plus profond. Le titre nous apprend donc que ce Clavier bien tempéré a été composé Au profil et à l'usage de la jeunesse musicienne avide d'apprendre et aussi pour Le passetemps de ceux qui sont déjà habiles En cette étude. Pour bien saisir toute la profondeur de ces indications, il faut avoir présents a l'esprit trois aspects fondamentaux de la vie de Bach * la pédagogie, la famille, et Dieu.
Chez Bach, la création est souvent indissociable d'une certaine dimension didactique, même si elle n'est pas toujours, comme ici, explicite. N'oublions pas que la pédagogie fait couramment partie de ses attributions. Par exemple au moment de la publication de ce Second Livre du Clavier bien tempéré, il était depuis vingt ans Directeur de la musique et Cantor de l'église Saint-Thomas. Il avait donc en charge l'éducation musicale des élèves de la paroisse de Saint-Thomas. Mais il devait aussi fournir une cantate pour chaque dimanche ; grâce à cela, plus de deux cents cantates, et autant de chefs-d'œuvre, nous sont parvenus. On peut y ajouter les Passions, l'Oratorio de Noel... Bach restait au plus près de la musique religieuse.
Chez les Bach, la musique est affaire de famille. On y est musiciens de père en fils. Si l'on prend comme point de départ le plus ancien Bach musicien connu, notre Jean-Sébastien fait déjà partie de la cinquième génération ! Et pas moins de quatre de ses fils deviendront compositeurs professionnels. Les professeurs sont le père, un frère aîné, un oncle... Même pour le plaisir, la musique est une pratique familiale : il n'est pas rare qu'à certaines occasions, ou sous le coup d'une impulsion, des chants à quatre voix surgissent dans la maison, passant sans transition de la prière la plus recueillie aux plaisanteries vocales les moins avouables.
Pour mesurer à quel point Bach avait une haute idée de l'art (que ce soit le sien, ou celui des autres, car il pensait sincèrement que quiconque s`appliquera autant que [lui] fera aussi bien, citons cette phrase à ses élèves : Toute musique dont la seule fin n'est pas de louer Dieu n'est pas du tout de la musique, mais un vacarme et un charivari infernal.
Le point commun à tout cela, à Dieu, a la famille et à la transmission ? L'amour, certainement. l'amour, pain quotidien de Bach, qui pouvait lui donner (et nous donner, si généreusement) autant de formes différentes que les quarante-huit Préludes et les quarante-huit Fugues du Clavier bien tempéré.
Préludes et Fugues
Dans les œuvres pour clavier, jusqu'à la fin du XVIe siècle, le Prélude était une improvisation qui permettait à l'interprète de se « faire les doigts » tout en prenant connaissance de l'instrument sur lequel il jouait. Puis il gagna une certaine autonomie, se développa, prit différentes formes, tout en gardant son caractère de liberté, de fantaisie, d'apparente improvisation. Dans le Clavier bien tempéré, le Prélude dépasse largement sa fonction habituelle, notamment dans le Second Livre, où nous le trouvons sous des formes plus variées que dans le Premier livre, et où il arrive qu'il soit plus long que sa Fugue correspondante. La Fugue, tout au contraire, représente la rigueur, la construction formelle dans laquelle aucune note ne pourrait être remplacée par une autre. Elle commence (et c'est absolument incontournable) par un thème, nommé « sujet », que l'auditeur retient aisément, et qui va, tout au long de la pièce, passer d'une voix à l'autre, se déformer selon de nombreuses règles qui, pour ludiques qu'elles puissent paraître (transposé, en augmentation, en diminution, inversé, en miroir, en écrevisse, ces procédés pouvant même se combiner entre eux) ne doivent rien au hasard. On entendra souvent ce thème, simultanément, sous plusieurs formes différentes. L'interprète doit faire en sorte que l'auditeur ne soit pas perdu, et qu'il puisse toujours entendre, quand il est présent, ce thème fuyant (d'où le nom de Fugue, du latin Fugere, « fuir »). Le nombre de voix des Fugues est très variable. Mais dans ce Deuxième Livre, elles sont soit à trois voix (pour quinze d'entre elles), soit à quatre voix (pour les neuf autres). Ces Préludes et ces Fugues ayant été écrits sur plusieurs décennies, et rassemblés par Bach pour leur publication, le lien entre un Prélude et sa Fugue correspondante peut être de tous ordres. Il serait vain d'y chercher systématiquement un rapport thématique, mais il serait bien dommage de les séparer. De nos jours, ce diptyque Prélude et Fugue, symbole du contraste (voire de l'antinomie), semble aller de soi. En réalité, il est indissociable de Bach, qui en écrivit bien d'autres, notamment pour orgue. Mais peu d'autres compositeurs de son époque ont franchi l'épreuve de la postérité avec cette forme. Quant a ses successeurs, beaucoup ont étudié avec admiration ce Clavier bien tempéré, même pendant toute la période où, après sa mort, Bach a été oublié ; mais, sans doute intimides parle si haut niveau atteint par Bach, très peu ont pris sa suite. En 1782, Mozart transcrivit pour Quatuor ou Trio à cordes plusieurs des Fugues. Il faut aussi citer les miraculeux Préludes opus 28 de Chopin (qui commençait toujours son travail au piano en jouant un ou plusieurs Préludes et Fugues de Bach) terminés en 1839 ; pas de Fugues ici, mais vingt-quatre pièces clans toutes les tonalités, qui s'enchaînent par quintes et non par demi-tons comme chez Bach. Et puis bien sûr, les monumentaux et bouleversants Vingt-quatre préludes et fugues opus 87 de Chostakovitch, écrits en 1950 pour le bicentenaire de la mort de Bach,
Le célèbre pianiste, chef d`orchestre et compositeur allemand Hans von Bülow (1830-l894) considérait que Le Clavier bien tempéré représentait l'Ancien Testament des pianistes, le Nouveau étant Les Trente-Deux Sonates de Beethoven. La formule vaut bien que l'on s'y attarde un peu. Dans les deux cas, nous sommes face à une somme d'une richesse incomparable, chacune amenant sa forme musicale à un niveau insurpassable. Chaque musicien peut s'en nourrir quotidiennement, que ce soit pour son propre acte créateur, pour sa pratique instrumentale où, grâce au disque ou au concert, pour son enrichissement personnel. Il y trouvera toujours ce qu'il cherche, et souvent bien davantage ! En ce qui concerne Le Clavier bien tempéré, si une lecture ou une écoute partielle se justifie aisément, il sera encore plus riche de considérer l'ensemble du Premier Livre, ou l'ensemble du
Second, comme un tout. Certes, les vingt-quatre Prélude et Fugues de chacun des Livres sont présentés dans un ordre systématique qui, sur le papier, semble tout droit sorti d'un manuel purement théorique (do majeur, do mineur, do dièse majeur, do dièse mineur, ré majeur, ré mineur, etc.). Mais leur écoute intégrale fait entendre bien autre chose. La manière d'enchaîner les tonalités a été, bien entendu, pensée par Bach. Et dans cet enregistrement, les temps de pause entre chaque pièce, que ce soit entre un Prélude et sa Fugue correspondante, ou bien entre chaque diptyque, rie doivent rien au hasard. Nous avons vu combien Bach a mis de sa Foi, quel amour il a donné, inspiré par l'Esprit, dans chacun de ces Préludes et Fugues. C'est ce qui leur confère leur portée universelle. Mais Bach se considérait davantage comme un artisan consciencieux que comme un génie supérieur. Ces quarante- huit Préludes et Fugues peuvent également être considérés comme autant de confessions, comme autant d'états d'âme. Chaque auditeur les recevra a sa manière... et chaque interprète les offrira selon son propre ressenti, qui pourra changer d'un moment à l'autre, d'un instrument à l'autre. Nous avons déjà vu que Robert Levin en a réalisé un enregistrement sur cinq instruments différents ; s'il avait fait le choix d'enregistrer cinq fois l'intégralité du Clavier bien tempéré, chacun sur un seul instrument ce qui n'aurait du reste pas été toujours possible pour des questions de notes qui n'existent pas sur tous ces instruments), nul doute que nous aurions pu constater de grandes différences entre deux versions d'un même Prélude et Fugue. Dominique Merlet a d'ailleurs déjà tenté l'expérience, jouant un même Prélude et Fugue, au cours d'un même concert, une fois au piano et une fois à ''orgue, avec des vitesses, et dans des caractères très différents. Mais surtout, au-delà de l'instrument, il y a la sensibilité de chaque interprète, qui donne à chacun de ces quarante-huit Préludes et de ces quarante-huit Fugues son interprétation particulière, originale, personnelle. Et face à tel monument, a la fois grandiose et humble, à la fois divin et humain, comment ne pas donner ce que l'on a de meilleur, ce qui est à soi, rien qu'à soi, mais que l'on va offrir bien volontiers, et qui sera reçu sans fausse pudeur, sans crainte d'en être ému ? C'est le mérite, et la vertu de ce Clavier bien tempéré : surtout quand, Premier ou Second livre, il est joué intégralement, comme ici, il se partage, et même si chacun le restitue et le reçoit différemment, il nous rassemble.
Les différentes tonalités classées en fonction des altérations:
Bach ordonne les préludes et fugues du clavier bien tempéré (WTC) par tonalité en suivant les demi-tons majeurs et mineurs de la gamme (chapitres de Décalages):
N° 1 : Do majeur -
N° 2 : Do mineur ♭♭♭
N° 3 : Do♯ majeur # # # # # #
N° 4 : Do♯ mineur # # # #
N° 5 : Ré majeur # #
N° 6 : Ré mineur ♭
N° 7: Mi♭ majeur ♭ ♭ ♭
N° 8 : Mi♭ mineur ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭
N° 9 : Mi majeur # # # #
N° 10: Mi mineur #
N° 11 : Fa majeur ♭
N° 12 : Fa mineur ♭ ♭ ♭ ♭
N° 13 : Fa♯ majeur # # # # # #
N° 14 : Fa♯ mineur # # #
N° 15 : Sol majeur #
N° 16 : Sol mineur ♭ ♭
N° 17 : La♭ majeur ♭ ♭ ♭ ♭
N° 18 : Sol♯ mineur # # # # #
N° 19 : La majeur # # #
N° 20 : La mineur -
N° 21 : Si♭ majeur ♭ ♭
N° 22 : Si♭ mineur ♭ ♭ ♭ ♭ ♭
N° 23 : Si majeur # # # # #
N° 24 : Si mineur # #
Les tempéraments associés aux tonalités:
Analyse du premier prélude WTC :
Au piano avec partition :
Ave Maria de Gounod:
Succession des Tonalité
C Dm/C G7/B C Am/C D7/C G/B C/B Am7 D7 G Gdim Dm/F Fdim
C/E F/E Dm G7 C C7 F7 F#dim Abdim G7
C/G G7/sus4 G7 Adim7/G C/G G7/sus4 G7 C7 F/C G7/C C